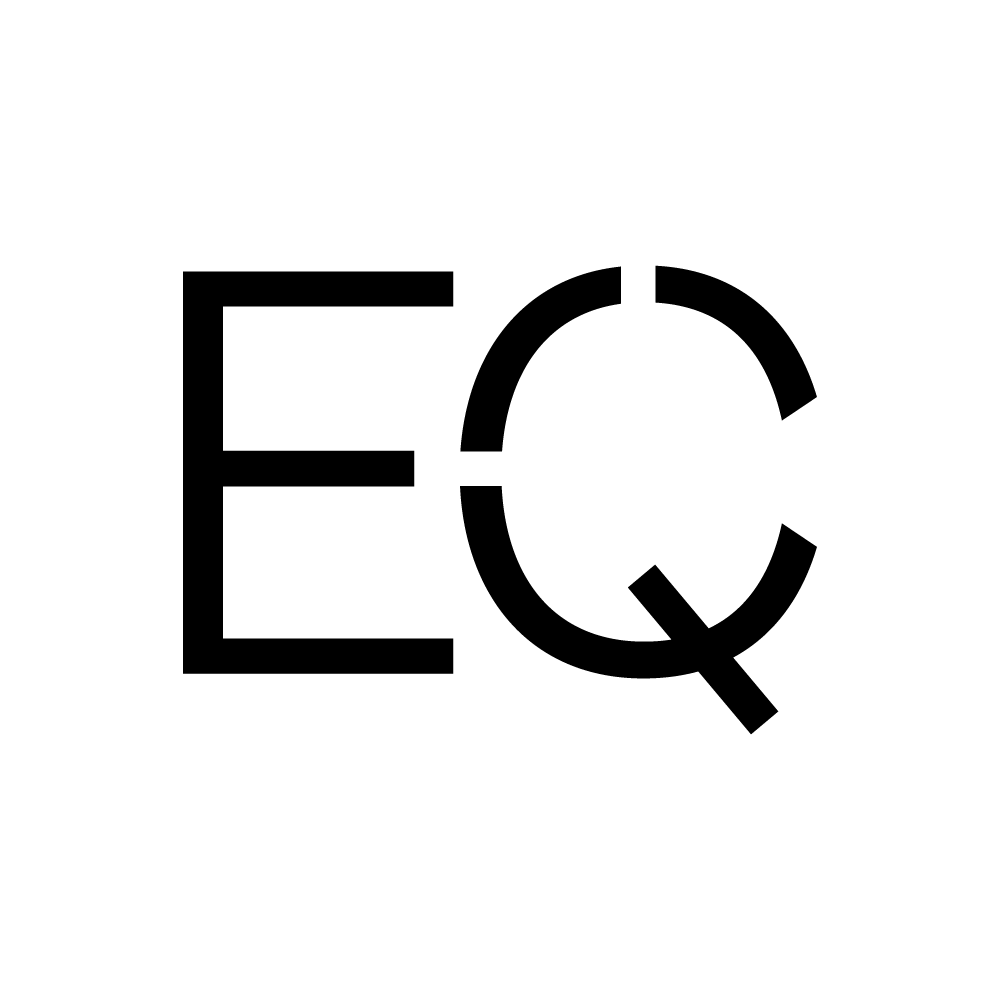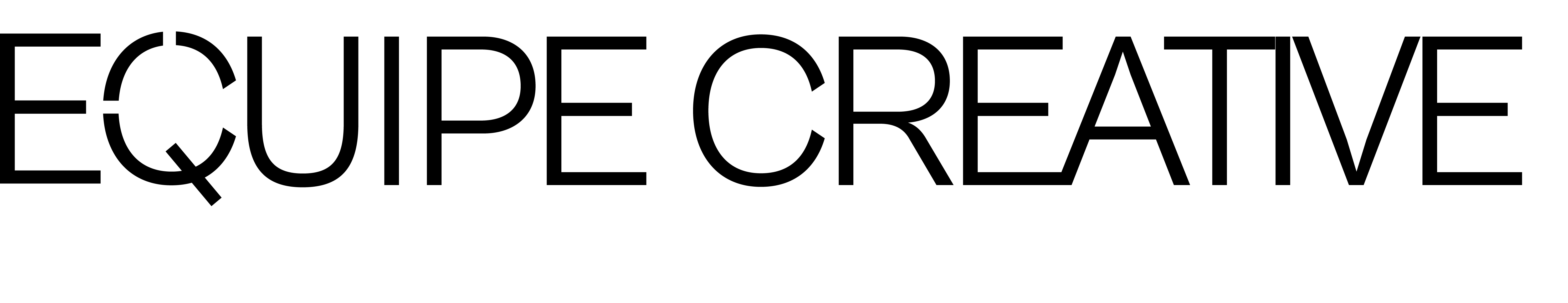Communauté de production artistique
Fondée en 2016 – Paris–Guebwiller
Sensible à l’historicité des lieux et des savoir-faire, Équipe Créative s’engage auprès de structures locales, d’artistes, d’artisans et de créateurs. En ce sens, elle s’attache à valoriser la technicité de personnes dont les métiers s’inscrivent dans des territoires et des temporalités propres.
Pour toute demande de collaboration, d'initiatives mettant à l'honneur les formes marginales d'expressions artistiques et les savoir-faire traditionnels, pour toute demande d'adhésion :
© EC 2024 – Tous droits réservés