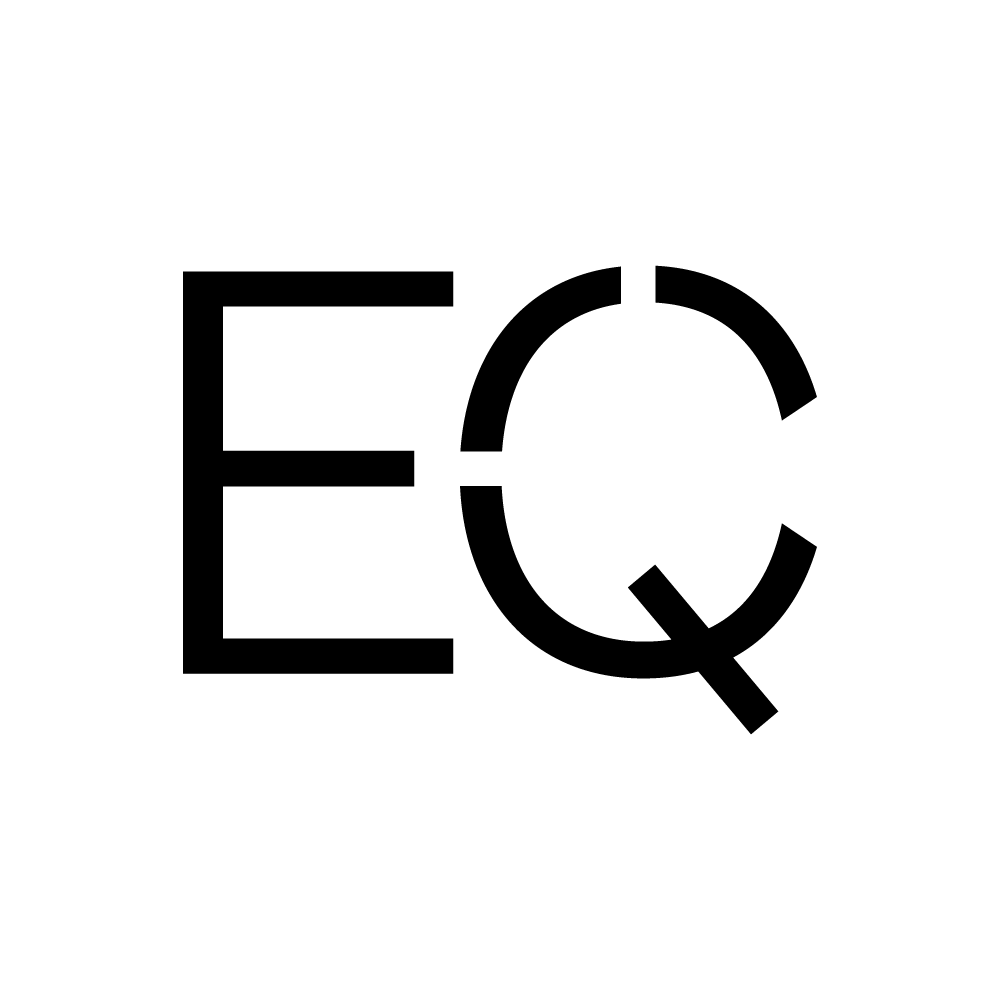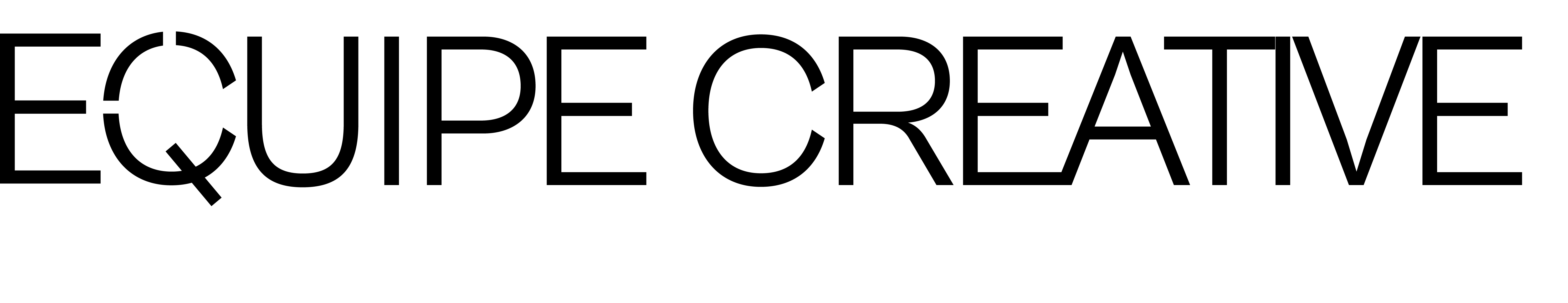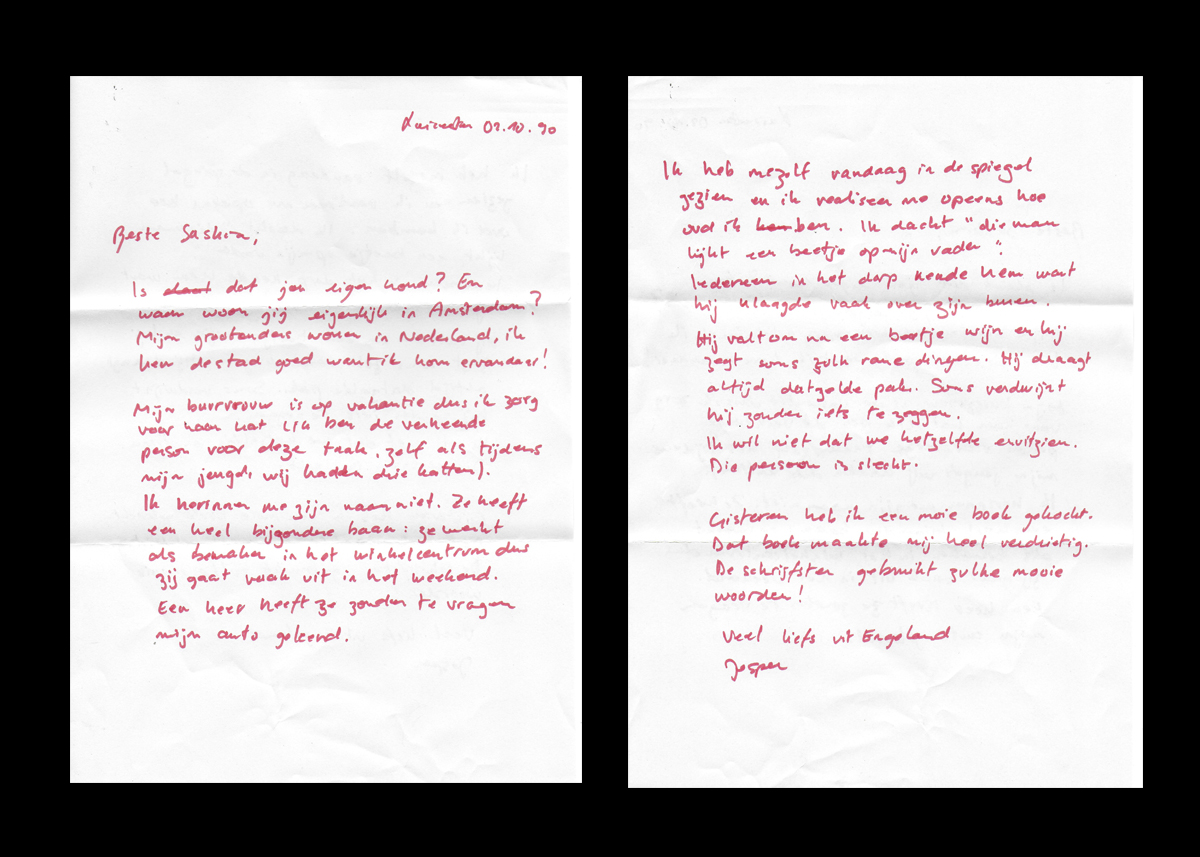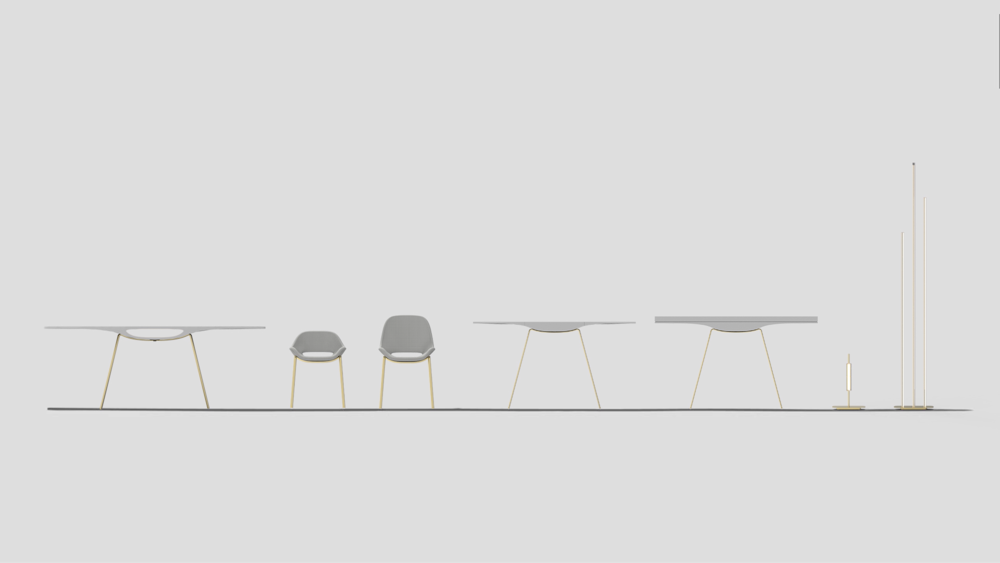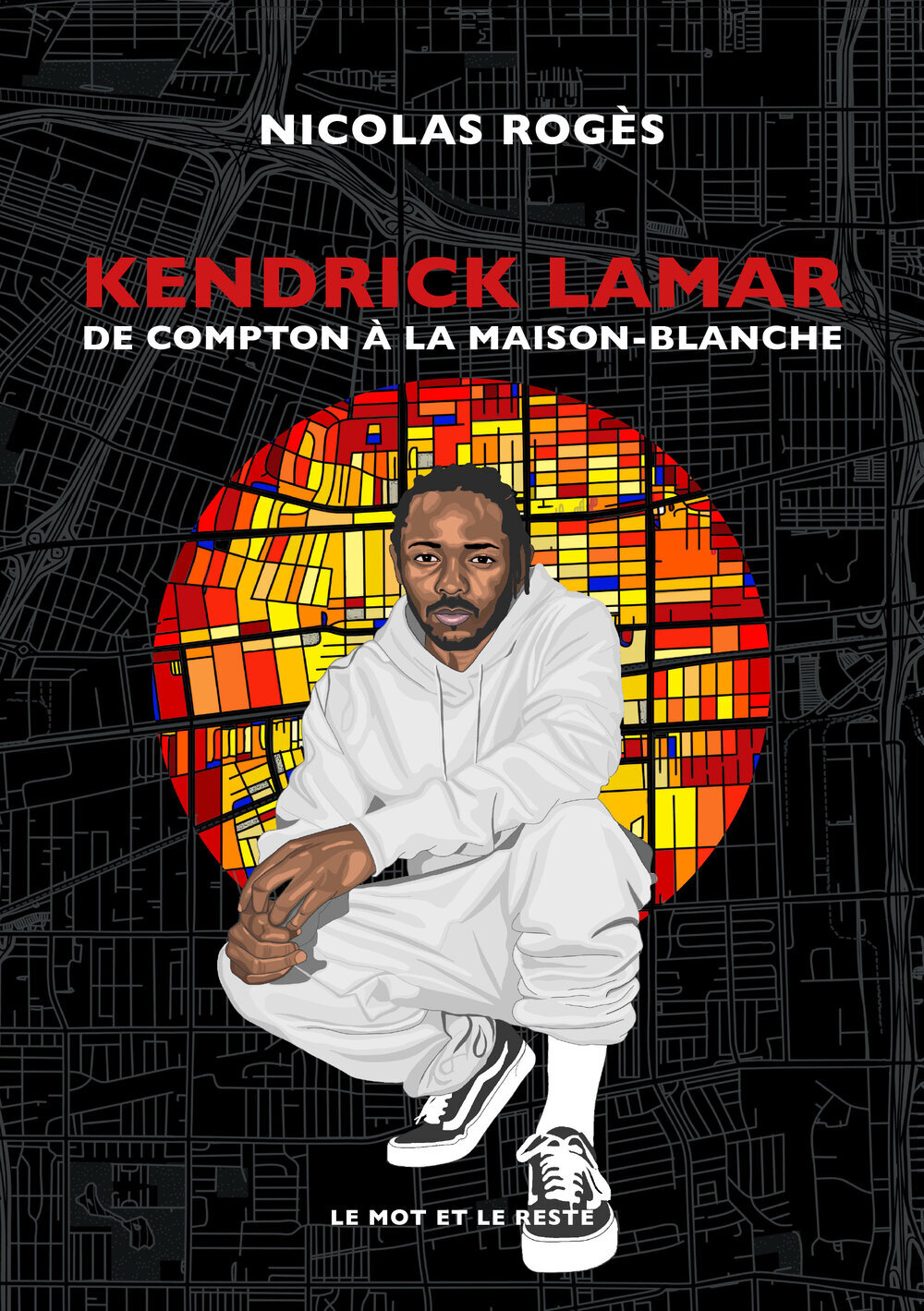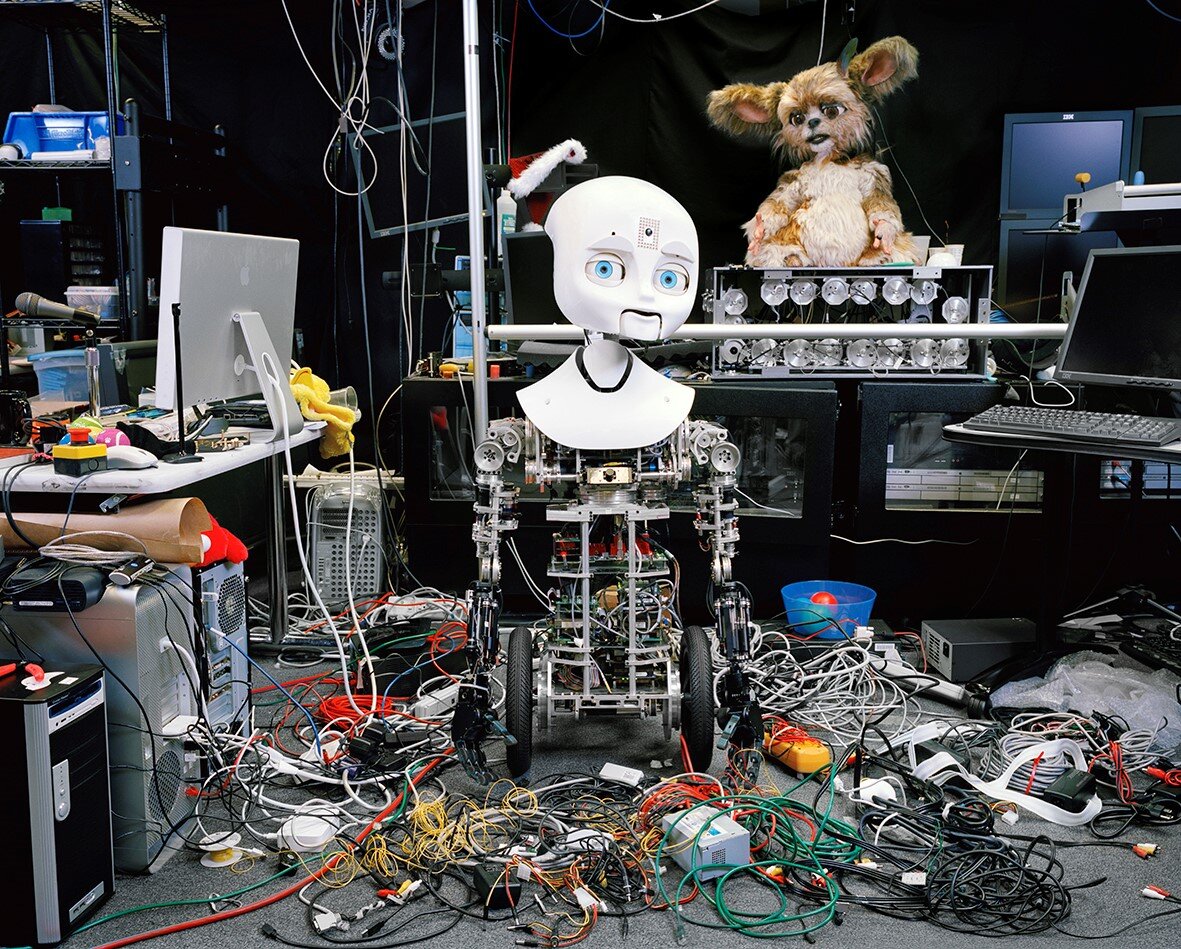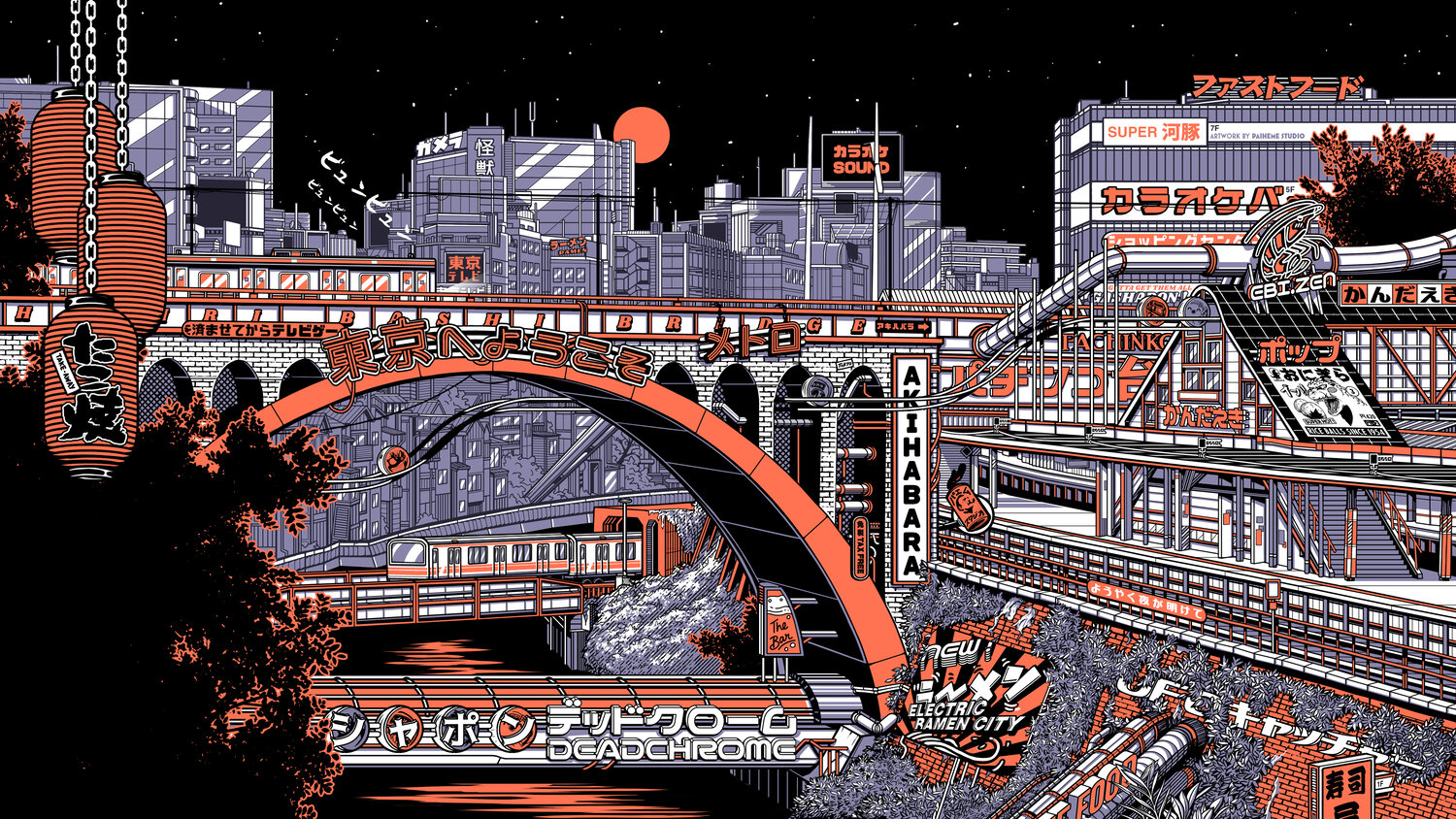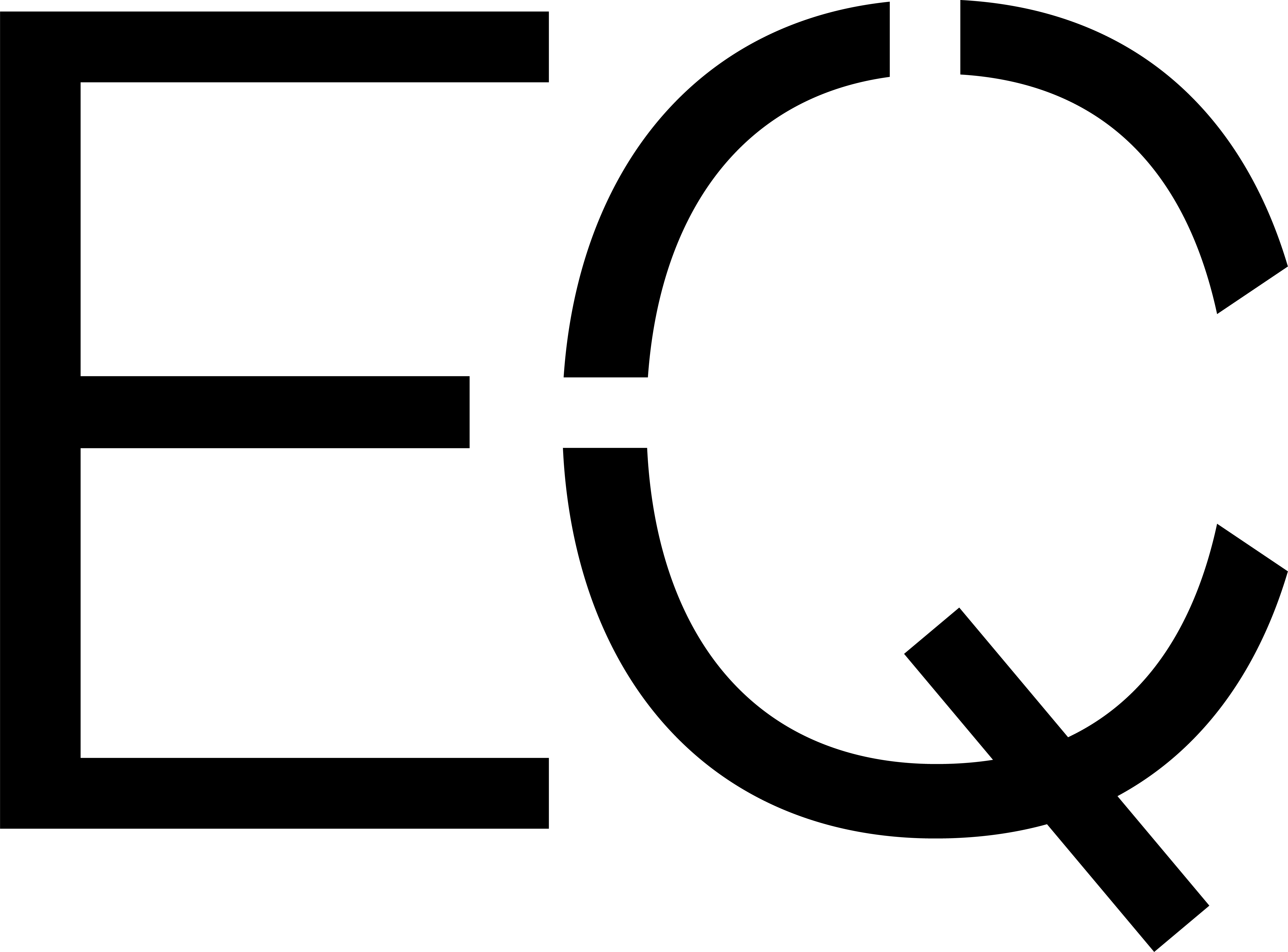E.C : Dans vos nombreuses références, quels écrits vous ont particulièrement marqués ? Y a-t-il des ouvrages qui se sont imposés à vous au point d’être des symboles d’une période de votre vie ?
V.H : Premièrement, Autrement qu’être de Levinas. Ça a été la période de l’adolescence, celle de l’absolu, de la radicalité (éthique plus que politique). Mais je pourrais ajouter Heidegger par la suite, qui m’a tout autant impressionné que rebuté, lorsque j’ai pu lire Être et temps (1927) ou les Beiträge zur philosophie (1936).
Il y avait, à l’Université de Strasbourg, d’éminents lecteurs de Heidegger quand j’y étudiais. De plus, la ville de Strasbourg a toujours été considérée, à tort ou à raison, comme un haut lieu de la transmission de la philosophie heideggerienne, puisque Lucien Braun, Lacoue-Labarthe et Nancy y enseignaient. À cette même époque, j’ai quasiment lu tous les ouvrages de ces deux derniers philosophes pour qui je garde une immense admiration. Il y a eu Marx, aussi. Ça a été la période des grèves de la LRU, la période estudiantine et politique — j’avais d’ailleurs en son temps rédigé un mémoire sur Marx et Badiou (assez critique à l’égard de ce dernier). Par la suite, j’ai beaucoup lu Derrida et Lacan en me laissant séduire par la profondeur labyrinthique de leur pensée et par leur style redoutable et à propos duquel il y aurait tant à dire, au-delà de tous les clichés des mélophobes de l’Université qui condamnent toute écriture parce qu’elle serait trop musicale ou littéraire. À la manière de Joseph II disant à Mozart : « Une musique formidable mon cher Mozart, mais il y a cependant quelque chose (…) Il y a je pense trop de notes dans cette partition ! »).
Enfin, j’ai été soufflé par Nietzsche — Aurore est pour moi un livre indépassable, chose que je partage avec mon ami et éminent spécialiste de Nietzsche, Dorian Astor — par Ethique de Spinoza ou encore par Freud – Propos d’actualité sur la guerre et sur la mort est une œuvre méconnue mais également indépassable pour comprendre notre crise sanitaire et écologique actuelle. Il y a aussi Malaise dans la civilisation. Au fond, je dirais après ces années d’étude et de lectures carnivores qu’il n’y a que deux monuments intangibles pour moi (c’est très partial, j’en conviens). Il s’agit de Platon et d’Hegel — et peut-être Kant et Nietzsche, car ce dernier est toujours devant nous et possède toujours un coup d’avance. Pourquoi ce choix ? Parce qu’ils ont tout dit. Le reste n’est qu’une paraphrase, ou bien une note en bas de page comme disait Whitehead. Plus ou moins habile afin de répondre aux problèmes de son temps. La philosophie n’est qu’une répétition. L’histoire de la philosophie demeure dans ce quasi-vers – insondable de profondeur – de Mallarmé, que je me suis permis de modifier : « Telle qu’en Elle-même l’éternité enfin la change ».
E.C : Votre deuxième ouvrage, L’Ecologique de l’Histoire (préfacé par J.-L. Nancy) devait sortir en avril aux éditions Diaphanes (collection « Anarchies »). Le premier qui s’intitulait Vivre(s) : malaise dans la culture alimentaire (Éd. Les contemporains favoris) est paru en 2018. D’où est partie l’idée des deux livres et que cherchent-ils à transmettre ?
V.H : Notre premier essai, Vivre(s) : malaise dans la culture alimentaire, essayait de dégager les conditions de possibilité d’une revitalisation de la vie exposée à sa dévitalisation, son appauvrissement et concourant à toutes les dépressions et tendances suicidaires (dont les deux signes majeurs sont le terrorisme et la crise écologique). Le terme d’ « alimentation » généralisait ainsi le régime même par lequel la vie survit, se fortifie ou s’appauvrit pour finalement dépérir. Comment réalimenter cette vie atrophiée ? Comment lui redonner le goût de vivre alors qu’elle est désormais privée des nourritures célestes que Dieu lui offrait, en guise de consolation, depuis des millénaires ? Le vivant humain doit, en cela, retrouver l’appétit et l’envie de vivre – sans Dieu. Autrement dit, le premier devoir du vivant, comme le savait Freud, est désormais de supporter sa vie sans support divin ni religieux. C’est-à-dire aussi éviter que la vie ne disparaisse tout bonnement. L’enjeu est donc, a fortiori, écologique.
Là était toute la question de notre second livre, L’Écologique de l’Histoire. Cet ouvrage essayait de dégager une pensée novatrice de l’Histoire au lendemain de la fin des grands récits à l’aune de ce que j’ai appelé l’éc(h)ologie. Si Hegel avait pensé celle-ci comme théo-logique, Marx comme polémo-logique et Heidegger comme onto-logique, le sens de l’Histoire occidentale est, pour moi, écho-logique. Pourquoi ? Car son déroulement est celui d’une appropriation prédatrice de la Nature (d’un arraisonnement technique), procédant d’une confusion quant au sens même du mot « appropriation ». Notre Histoire est l’histoire de cette confusion. Cette dernière provient d’une mésinterprétation du terme grec ekhein (« avoir ») qui ne signifie pas une possession morne (le grec a un mot pour cela : ktèsis), ni une appropriation prédatrice ou une accumulation de marchandise, mais désigne le fait de laisser une chose se déployer proprement selon son essence. De ce fait, l’ « appropriation », originairement, ne signifie pas une saisie, un arraisonnement, mais bien un procès de propriation de soi.
Par la suite, on a tenté de dégager la logique paradoxale et propre de l’Occident, en se partageant d’une part entre une échologique arraisonnante et technocapitaliste — cherchant à soumettre la Nature en vue de la maîtriser et d’en dégager des richesses économiques — et d’autre part, une échologie insue s’exhibant sourdement en filigrane de la première, et par laquelle « l’avoir » reviendrait à son sens primitif tel que défini par Platon ou Aristote : ce qui se déploie selon les lois propres de sa nature, c’est-à-dire qui possède une disposition à se déployer proprement dans son essence. C’est cette dernière échologique qui constitue le défi de notre temps et qui appelle une écologie politique qui ne soit pas frileuse, mais radicale. Comment laisser être la Nature dans son procès de propriation, lui permettant de garantir l’équilibre de ses écosystèmes et, par conséquent de la vie en général — y compris la vie humaine qui en fait partie ? Il faudra penser une invention juridique inouïe, un droit de la Nature, garantissant cette dernière comme sujet et entité vivante comme c’est déjà le cas en Nouvelle-Zélande ou dans certains États américains. L’Histoire occidentale doit ainsi passer d’une échologistique (système technocapitaliste d’arraisonnement du monde) à une écologique (entendue comme écologie politique) ayant à repenser notre co-appartenance au monde en vue de la sauvegarde de la vie terrestre.
E.C : À quoi tient pour vous la différence entre ces deux livres et entre leur écriture ? Vous aviez, par le passé, rédigé une thèse de doctorat. Que vous a appris l’écriture d’un livre par rapport à l’écriture d’un travail universitaire ?
V.H : Du point de vue du style, je dirais que le second ouvrage témoigne d’une sobriété bien plus grande. Le premier livre est un essai ivre, un cri pour la vie rédigé quelques mois après les attentats islamistes perpétrés en France en 2015. J’ai cru durant mes études que l’on pouvait écrire de la philosophie dans une sorte d’emportement bachique, en tenant chaque phrase d’un même souffle. Je crois désormais que l’écriture philosophique doit savoir ménager du temps pour une démonstration patiente. Même si elle cherche toujours son rythme propre qui est commandé par le problème soulevé ou l’objet traité. Un livre sur l’ivresse de vivre, sur la bonne chair pouvait être ivre, mais un livre sur le désastre de la prédation technocapitaliste et la crise écologique devait trouver une autre tonalité, un autre ton. En bref, tenir une autre note.
Par ailleurs, je ne saurais dire ce qu’un livre a de différent avec un travail universitaire. Du moins, avec ce qu’a été mon travail universitaire. J’ai rédigé mon mémoire et ma thèse avec le même enthousiasme que j’écris désormais mes livres. Je dirais toutefois qu’il y a des contraintes académiques plus fortes à l’Université. Dans un livre, on peut tout dire. L’Université bride davantage et part précisément du présupposé inverse : on ne peut pas tout dire. Toute écriture libre est suspecte. Au reste, ce qu’on se croit autorisé de dire, si on ne s’est pas déjà auto-censuré, doit être référencé, justifié. À toute phrase, disait Lacan (en parlant du discours universitaire), doit présider le nom d’un auteur en tant qu’autorité tutélaire d’un pair, qu’il soit philosophe ou professeur. Du point de vue professoral, le directeur de thèse incarne cette instance. Par essence, l’université est patriarcale car c’est le Pair/Père qui domine l’écriture. Ce sont d’ailleurs ces noms qui dominent les courants universitaires. Il y a bien des platoniciens, des cartésiens, des kantiens, etc. Un universitaire digne de ce nom répond d’un Pair et du nom d’un Pair. Je crois qu’écrire un livre revient fondamentalement à tuer le Père, c’est-à-dire l’autorité d’un autre auteur que soi. En bref, c’est parler en son nom, se faire un nom propre. Dire « je », et non pas « nous ».
En vérité, si l’on peut savoir comment écrire un travail universitaire, on ne sait jamais écrire un livre. Il n’y a pas de savoir de cela.
E.C : Vous évoquiez dans votre premier ouvrage le problème — freudien — d’une Humanité qui, ne croyant pas à sa propre mort, déchaîne sa pulsion mortifère au risque de s’anéantir elle-même. La crise sanitaire actuelle, provoquée par la pandémie du Covid-19, s’inscrit-elle dans cette problématique ?
V.H : Le problème que je pose depuis mon premier ouvrage Vivre(s) : malaise dans la culture alimentaire est celui du suicide, au fond. Le seul problème philosophique vraiment sérieux, disait Camus (à raison, je crois). Comment l’Humanité pourra-t-elle survivre à sa longue tentative de suicide alors même qu’elle ne croit pas à sa propre mort ? Ce problème était déjà celui de Freud dans ses Propos d’actualité sur la guerre et sur la mort. La Première Guerre mondiale avait révélé, pour lui, le savoir le plus profond de la psychanalyse : celui que l’humanité est prise depuis toujours dans le conflit de deux pulsions contradictoires, la pulsion de vie (pulsion d’association) et la pulsion de mort (pulsion de dissociation, guerre de tous contre tous, auto-anéantissement du genre humain dans un long suicide aveugle et infantile). Quelle pulsion l’emportera ? Celle de vie ou celle de mort ? La réponse est incertaine. Reste que, si l’Histoire continue de répondre de son écho-logique technocapitaliste, il est à tout du moins certain que l’humanité tranchera cette question ambivalente de manière morbide, c’est-à-dire en s’anéantissant.
La crise du Covid-19, pendant laquelle nous avons assisté malgré les mesures de confinement à une inconscience générale quant à des risques réels (regroupement d’individus sur les berges des fleuves, agglutination de masses dans les marchés…), s’inscrit en effet, et pour une part, dans cette logique mortifère. La mort relève toujours, pour l’animal humain, d’une altérité si radicale que celle-ci ne semble jamais pouvoir arriver à soi. C’est bien connu : « Ça n’arrive qu’aux autres ». Cette croyance en sa propre immortalité que Freud a découverte il y a un siècle pose aujourd’hui le problème général de la survie de l’humanité. Alors même que nous sommes menacés par la disparition de la vie sur Terre, nul ne change ses habitudes – lesquelles, on le sait, ont toujours la vie dure.
J’ai formé le pari, dans L’Écologique de l’Histoire, d’un infléchissement de notre économie libidinale permettant de créer les conditions de possibilité d’une économie politique qui puisse être écologique. Quelle est notre économie libidinale, aujourd’hui ? Celle déterminée par le technocapitalisme. Or, comment se détermine-t-elle ? Par le discrédit, la dette. Le système d’endettement et de crédit du capitalisme définit la vie comme fondamentalement endettée et discréditée. La vie, étant dévaluée par nature, trouverait ainsi prétendument dans l’argent et la possession de biens la possibilité de se satisfaire elle-même. Le technocapitalisme a donc besoin de discréditer la vie pour qu’elle puisse espérer trouver dans les crédits et la consommation ce qui lui permettrait de retrouver l’estime de soi.
En opposition à cela, ce que nous avons forgé comme hypothèse est qu’une écologie politique ne pourra advenir que si la vie cesse d’être amoindrie dans son amour d’elle-même. Il s’agirait en cela de la restituer à l’amour de soi qui la définit comme conservation de soi. La croissance économique, monétaire, s’oppose à la croissance de la vie et à celle de l’amour pour la vie en général — incluant ici tous les vivants : la faune et la flore — comme l’économique s’oppose à l’an-économique. Discréditée, la vie ne peut que négliger la vie dans le sens où, étymologiquement, la « négligence » signifie l’absence ou la rupture de lien. La vie négligée n’est plus liée à la vie du monde et « comme » monde. Il s’agit donc de repenser de manière systémique notre modèle marchand afin de le rapporter à une mesure qualitative et non plus quantitative. Car la qualité de vie emporte avec elle non seulement notre bien-être mais également la sauvegarde des écosystèmes et de l’environnement. Pas plus que l’amour, la vie n’est monnayable. Irréductible, inconditionnelle, celle-ci n’a pas de prix. C’est ce luxe de la vie qui doit la rendre indisponible à toute prédation.
Plus largement, cette logique morbide de discrédit et de dévaluation est celle qui opère dans l’écho-logique de notre Histoire, n tant que procès de prédation technoscientifique et économique visant à arraisonner la Nature afin d’épuiser ses ressources et d’en tirer des richesses marchandables. La crise sanitaire actuelle n’est qu’une métonymie de la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons déjà. Avoir le sens de l’Histoire, c’est saisir la portée de cette crise et chercher à infléchir ce mouvement afin d’entrer dans une écologie cosmopolitique digne de ce nom (ce qui en passera, qu’on le veuille ou non, par une nouvelle Internationale). Le sens de notre Histoire se révèle ainsi dans cette crise sanitaire : on commence enfin à parler d’un changement de vie et d’habitudes, on interroge le sens de nos existences, de nos libertés, le sens de notre économie. Autrement dit, on commence à saisir, petit à petit, qu’il nous faut changer de modèle civilisationnel et que le technocapitalisme, comme maîtrise prédatrice de la Nature, n’est plus possible. Malgré tout, ces changements ne sont pas pour demain, mais je suis persuadé que le confinement de plus de 3 milliards de personnes laissera en nous des traces inconscientes qui feront leur chemin et prépareront — du moins je l’espère — de vastes mutations du monde et de notre manière de faire monde. C’est ce que j’essaye d’ailleurs de penser dans un livre en préparation qui sera la suite de L’Écologique de l’Histoire et qui s’intitulera De la cosmétique. Ce terme, venant de kosmos (le monde, en grec), cherche à déterminer les conditions de possibilité d’une coappartenance harmonieuse des vivants et des non-vivants afin de garantir la permanence de la vie terrestre.
Il est intéressant de constater, relativement à cette pandémie, que la Chine est le pays le plus pauvre en forêts : 16 % de ses terres seulement sont recouverts par celles-ci (contre 74% au Japon !). La déforestation a débuté à l’époque du Grand Bond entre 1958 et 1965 afin de produire le combustible nécessaire à la production d’acier, dans laquelle les Chinois s’étaient spécialisés. Cette déforestation est corrélée avec la propagation des virus des animaux sauvages à l’être humain. La destruction du monde sauvage libère les virus qui s’y trouvent, leur diffusion est donc plus rapide et plus large. La crise sanitaire actuelle est donc bien une crise écologique. La seule réponse à donner à cette appropriation aliénante du monde, réduisant celui-ci à une map monde ou à un globe économique au sein duquel la beauté de la vie et de tous les vivants est touchée par l’immonde et la négligence est une réponse écologique. Seule celle-ci pourra d’ailleurs prévenir les épidémies futures. De l’échologie arraisonnante à l’écologie cosmopolitique, voilà le sens désormais de notre Histoire.
E.C : Votre partage de réflexion et de votre passion se fait aussi à travers votre métier d’enseignant. Apprenez-vous, face à des élèves, la manière dont doit aujourd’hui être transmise la réflexion philosophique ? De quelle manière la transmission orale a pu influencer chez vous la transmission écrite (et inversement) ?
V.H : Comme je le disais, l’enseignement s’est imposé à moi car je voulais donner ma vie à l’écriture. Non que l’enseignement était visé seulement comme « gagne-pain » permettant de dégager du temps pour écrire, mais qu’enseigner était pour moi (et est toujours) une manière de vivre dans et pour l’écriture. Préparer un cours nécessite des lectures, une rédaction — celle-ci n’est jamais très éloignée de ce que j’écris personnellement. Cela nécessite également une clarification des problèmes et un éclaircissement conceptuel. Ce qui n’est rien de plus que le sens même de l’écriture philosophique, bien que celle-ci passe, dans le professorat, par l’oral.
Par ailleurs, l’avantage d’enseigner est de s’affronter à la difficulté même de toute pédagogie, d’émission ou de transmission d’un sens : celui de la clarté. Face à des élèves (mais ce devrait être aussi le cas face à des étudiants), on ne peut se lover bien au chaud au creux de notre langue auto-référentielle. Enseigner, c’est avoir à se désaxer de tout ce que nous pensions être connu ou bien connu et qui, en tant que tel, est — je cite ici Hegel — méconnu. On ne peut pas tricher devant une classe . Le cryptage de la langue ne marche pas (alors qu’il peut fonctionner à l’université). Il n’y a nulle plus-value à l’obscurité. Le concept doit retrouver son caractère charnel : l’exemple. Il n’y a pas d’enseignement philosophique ni de philosophie sans exemples. Un sujet de bac tombé dans les années 70 (et qui ne pourrait plus tomber aujourd’hui, ce qui en dit long sur le désastre scolaire français) demandait : « Que peut un exemple ? » Formidable ! C’est là la question de toute philosophie et de tout enseignement. Je crois qu’un très bon enseignant n’est pas un funambule ou un virtuose des concepts (c’est assez simple au fond de les manier). Un bon enseignant, c’est un donneur d’exemples. Il donne corps au concept par l’illustration qu’il en fait.
Cette manière d’enseigner n’est rien de plus que ce qui est requis lorsque l’on prétend écrire de la philosophie. Un philosophe est, certes, un créateur de concepts, mais il est aussi un créateur d’exemples. L’un ne va pas sans l’autre, et plus et mieux, l’un appelle l’autre.
Enfin, je dirais qu’enseigner, c’est aussi se laisser enseigner. Pour l’anecdote, une page entière de L’Écologique de l’Histoire est inspirée d’une remarque qu’un élève m’a faite quand j’enseignais à Nancy — c’est dire si parfois les fulgurances des élèves donnent à penser. Je ne suis pas pour autant de ceux qui croient que l’élève est un « apprenant » et qu’il aurait à former par lui-même le savoir qu’il convient d’acquérir. Tout cela provient du discours managérial qui contamine désormais l’école. On n’enseigne plus, on forme. L’élève est celui qui doit s’auto-former. Mais cette prétendue formation sert avant toute chose à faire de l’élève un produit conforme au marché du travail, où il aura à se former incessamment pour diversifier ses activités. Tout cela confine au conformisme le plus bête. Il y a un maître (et le maître est celui qui nous apprend à n’avoir plus aucun maître que soi, c’est-à-dire à être libre) et un élève. Le mot « élève », dont je ne connais pas d’équivalent dans une autre langue, est certainement l’un des mots les plus admirables de la langue française. L’élève est celui que le maître doit élever, celui qui doit s’élever par le travail et l’étude. Plus épatant encore, il est également celui qui, par un éclair, élève le maître à qui il parle.